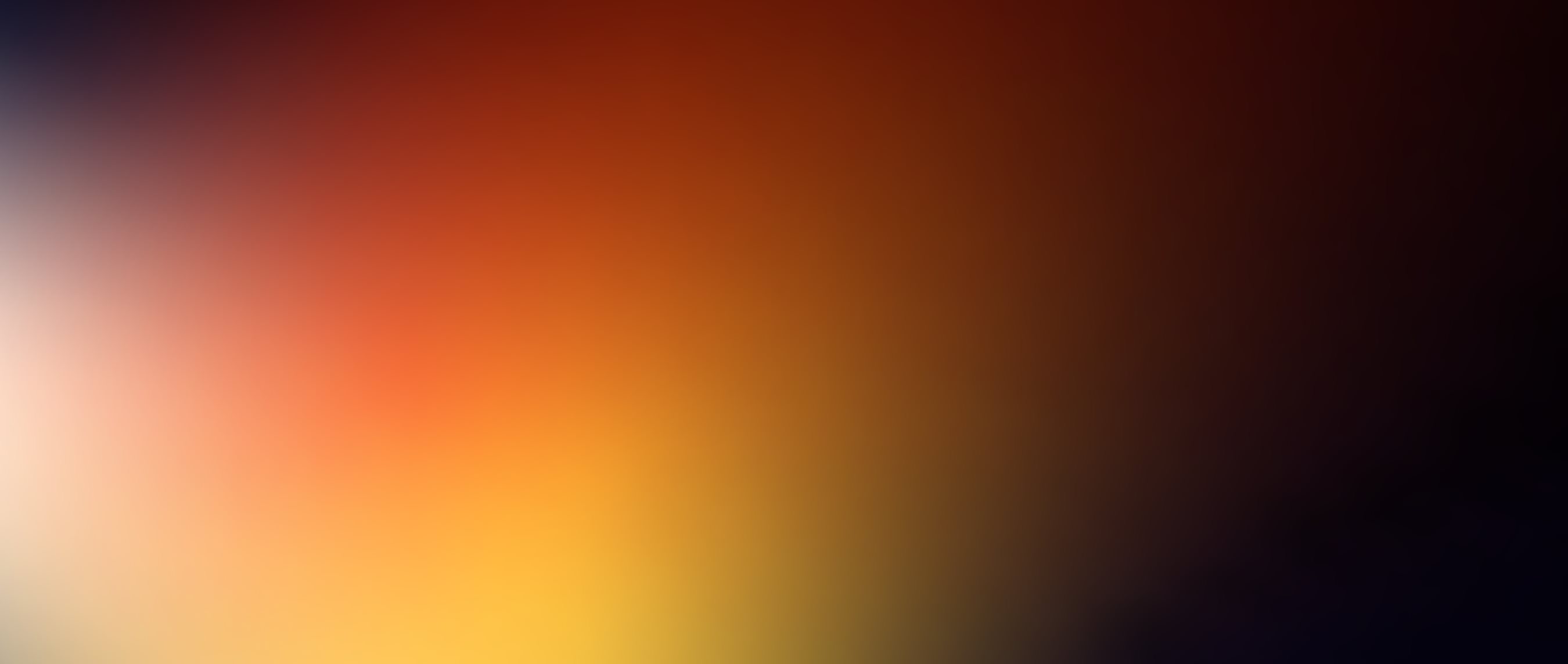Le plan-séquence consiste à filmer une action en une seule prise continue, sans recourir au montage pour changer d'angle ou de plan. Pour apprendre cette technique cinématographique ainsi que bien d'autres, la 4e année Réalisation du CLCF est une formation adéquate. Découvrez ce qui se cache derrière le plan-séquence.

Qu'est-ce qu'un plan séquence ?
Le plan-séquence est une séquence de film tournée en une seule prise, sans interruption visible du début à la fin de l'action représentée. À la différence d'une scène traditionnelle, où le réalisateur multiplie les coupes et les changements de plan, le plan séquence s'appuie sur une chorégraphie précise qui implique les acteurs et les l'équipe technique.
Le plan-séquence nécessite une grande préparation : répéter les déplacements des acteurs, s'assurer que la caméra puisse circuler sans encombre et coordonner chaque détail du décor. Avec l'absence de coupure, la temporalité réelle du tournage coïncide avec celle de l'action vécue à l'écran.
Cet effet de continuité procure une immersion dans le scénario. Le spectateur suit les personnages presque en temps réel, ce qui donne l'impression de vivre l'événement au plus près.
Les techniques du plan-séquence
Réaliser un plan-séquence réussi n'est pas chose facile. Dans les tournages classiques, il est possible de multiplier les prises et de recourir au montage pour préserver les meilleurs instants. La réussite du plan séquence repose sur la coordination parfaite de la caméra, des comédiens et du décor. Au moindre faux pas (un acteur qui oublie sa réplique, une lumière mal positionnée, un figurant égaré, etc.), il faut tout reprendre de zéro.
Le choix du matériel a également son importance : la fluidité du résultat dépend des dispositifs de stabilisation utilisés ou de la mise en place de grues et de rails. L'éclairage et la configuration spatiale doivent être élaborés pour rester cohérents durant toute la prise, même si la caméra traverse différentes pièces ou des espaces extérieurs.
Le plan-séquence demande un vrai travail d'équipe : le réalisateur, le chef opérateur, le département son, les acteurs, etc., doivent synchroniser leurs actions pour donner vie à une continuité parfaite.
Le plan-séquence et la narration immersive
Le plan-séquence sert souvent une intention narrative. Certains cinéastes y recourent pour souligner l'unité de lieu et de temps : le spectateur s'immerge dans une fête, se promène dans les méandres d'un couloir d'hôpital ou encore suit un personnage dans un long travelling urbain. Le spectateur ressent le fil de l'histoire comme s'il la vivait en direct, sans artifice de montage.
Cette immersion peut renforcer l'intensité dramatique. Dans un thriller, un plan-séquence peut suivre le protagoniste à travers des corridors sombres. Un sentiment de stress naît du fait qu'on ne peut pas couper : si un danger surgit, le public le découvre en même temps que le personnage. Dans une comédie, ce dispositif peut faire ressortir l'aspect chorégraphique ou burlesque d'une scène, comme lorsque plusieurs acteurs interagissent en temps réel, avec un ballet précis d'entrées et de sorties de champ.
Les différentes façons d'aborder un plan-séquence
Plusieurs moyens peuvent servir le plan-séquence :
- Le long travelling : La caméra se déplace en douceur, pour suivre un personnage dans son cheminement.
- La caméra fixe : Un plan-séquence peut aussi rester statique, si l'action se passe entièrement dans un même cadre.
- La caméra portée : Elle s'adapte aux mouvements erratiques d'un personnage ou capte le chaos d'une scène de foule.
- Le plan séquence invisible : Parfois, plusieurs plans sont habilement raccordés pour donner l'illusion qu'il n'y a pas de coupe.
Ces approches peuvent se combiner ou être adaptées en fonction du genre cinématographique. Le choix final dépend du style du réalisateur, de la nature de l'action et du message qu'il souhaite faire passer.
La 4e année Réalisation du CLCF aide à apprendre ces différentes techniques. Cette école de cinéma réputée aide ses apprenants à acquérir le savoir théorique nécessaire pour percer dans le domaine du petit ou du grand écran.
Quelques exemples de plans-séquences connus
Dans Shining, Stanley Kubrick a eu recours à une longue prise pour suivre Danny déambulant en tricycle dans les couloirs de l'hôtel Overlook. Le mouvement régulier de la steadicam, sans interruption, crée un sentiment d'angoisse latente : le spectateur est présent dans ce labyrinthe effrayant et partage la vulnérabilité du petit garçon.
Dans Les Infiltrés de Martin Scorsese, la scène où le couple entre par la porte de service du Copacabana est filmée en un seul plan-séquence. Le spectateur accompagne le protagoniste de l'extérieur jusqu'à la salle de spectacle en traversant couloirs et cuisines. Cette absence de coupe montre la montée en puissance du personnage dans la pègre.